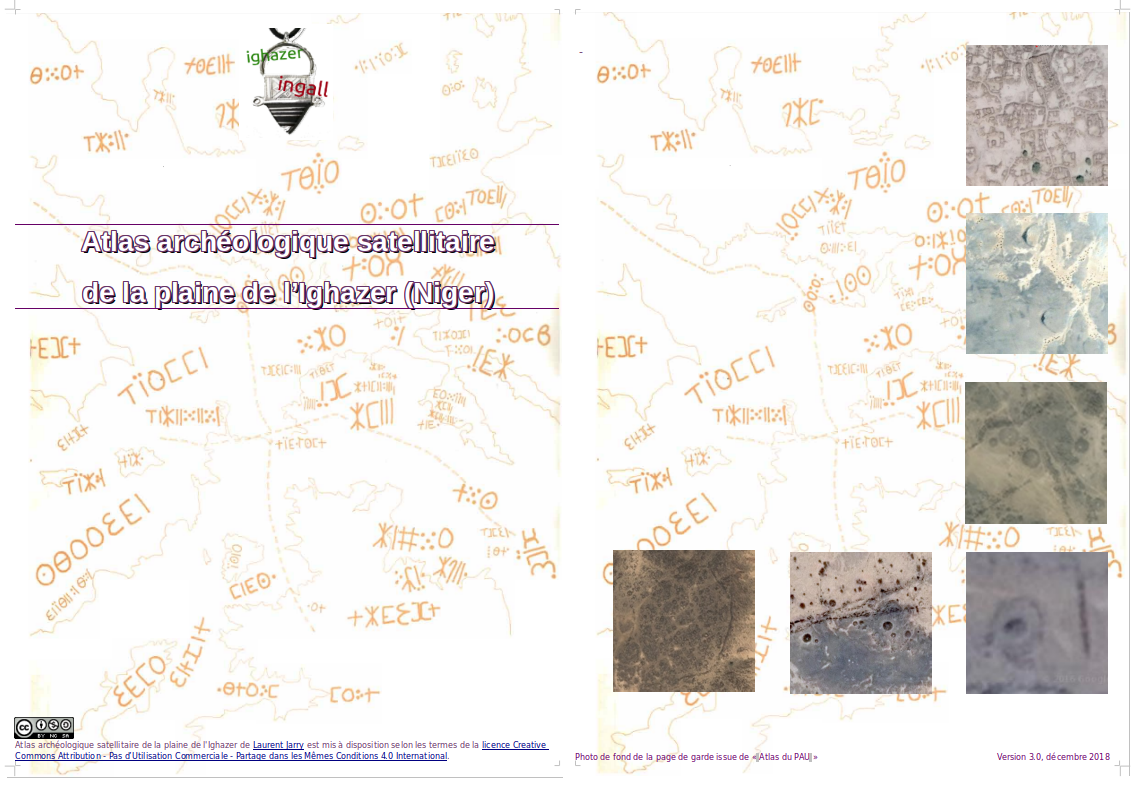Hier
Aux confins de l'Aïr et de l'Ighazer ... un carrefour de l'histoire des hommes voilés.
|
|
Le Domaine de Maranda |
Les causes climatiques, le développement du commerce transsaharien mais aussi peut être l'insécurité résultant de la mise en place de nouvelles populations, vont pousser, peu à peu, les métallurgistes du cuivre et du fer de la fin du néolithique à regrouper, au moins temporairement, leur habitat dispersé et nomade, au profit du premier véritable centre urbain de l'Ighazer, Maranda. Ce sera le point de convergence des savoirs et savoir-faire de l'Ighazer, à l’aube de l’islam, étape du commerce transsaharien. Ce mélange des genres amènera dans notre plaine, au cours du premier millénaire, de nouvelles céramiques avec des décorations typiques, et surtout une augmentation de la production du cuivre, dont Maranda sera un centre d'affinage et de transformation. Des milliers de petits creusets se retrouvent sur le site, le cuivre provenant de la plaine de l'Ighazer, mais aussi du commerce transsaharien, probablement grâce à un savoir-faire particulier.
|
|
Les Abzinawa de l'Ader |
Avant l’arrivée des Abzinawa en Ader, l’Azawagh été occupait par des Kurfeyawa, ancêtres des gens de Kurfey, et le sud Ader par des Asenawa cavernicole. Seuls les Kurfeyawa ont résisté à l’assimilation mais en s’exilant vers le Kurfey et revenant plus tard au nord de l’Ader (Nicolas 1950). Le massif de l’Aïr ou Abzin et ses environs était aussi occupé par des populations noires qui furent peu à peu refoulées ou assimilées (Bernus et al. 1986). L’ensemble des traditions orales, des émigrés comme des immigrés, correspondent pour en faire des populations hausaphones. Cet article tente de retrouver une partie de ces populations de l’Ayar qui aujourd’hui occupent l’Ader entre Tahoua et Madaoua et d’en définir leurs principales caractéristiques pour tenter d’en reconstituer le positionnement tant géographique que culturel et politique en Ayar. Les populations qui sont issues de l’Aïr ou Abzin en Hausa sont le plus souvent dénommés Abzinawa, terme encore usité aujourd’hui pour désigner, de l’extérieur donc et du Kasar Hausa en particulier, les habitants originaires de l’Aïr.
|
|
L'arrivée des Touareg |
La phase finale de l’art rupestre au sud du Sahara est dénommée « cameline », et se distingue par des gravures et peintures qui sont situées près de puits et le plus souvent sur des parois bien en vues. Les personnages, de dimensions importantes, sont traités sur un plan frontal et vêtus d’un habillement nouveau dans l’art rupestre saharien, fait d’habits amples et bien couvrants. Ils sont aussi souvent armés de plusieurs javelots, montent des chevaux et dromadaires à silhouette levrettée et s‘adonnent à la chasse à courre aux autruches, antilopes et girafes (Dupuy 1993).
|
|
La route du Kawar |
La route du Kawar, la caravanière pour Le Cœur (Le Cœur 1985), est un axe transsaharien nord-sud qui relie la tripolitaine au Lac Tchad, le Kawar étant une étape obligatoire en raison de ses sources en plein désert du Ténéré. Pour rejoindre le Fezzan à partir du Kawar, deux voies principales se séparent à Seguedine, encadrant ainsi le bassin de Murzuq désertique. La première vers le nord-ouest passant par le Djado puis la région de Ghat et le Fezzan ou vers le sud tunisien, la seconde plus orientale prenant la direction de Zawila par quelques rares oasis comme Tedjéré, c’est peut être cette dernière qui fut la plus utilisée. Pour relier le Lac Tchad à partir du Kawar, une seule voie plein sud via Agadem.
|
|
Le Royaume de Tigidda |
L’effervescence qui traversa les tribus nomades sanhadjiennes Gdāla, Lamtūna et Masūfa des rivages atlantiques du Sahara à partir des années 1040, fut le début du mouvement qui allait prendre le nom d’al-murābiṭūn, les Almoravides (Cheikh 2023). Les Sanhadja sont un ensemble de tribus berbères, hommes voilés du désert, dont certains Touaregs sont les descendants les plus directs (Khelifa 2010). Ils furent les premiers à lever toutes les barrières politiques, religieuses, commerciales en établissant un empire allant du Sud du Sahara jusqu’à Al-Andalus. La conversion à l’islam des populations soudanaises, attribuée aux Almoravides par la tradition sunnite dominante, a consisté en fait à leur imposer un islam malékite orthodoxe (Botte 2011).
|
|
Azelik-Takadda, la capitale |
Azelik-Takadda fut une importante cité commerciale, située à environ 130 km au nord-ouest d'Agadez. En surface, se rencontrent nombre de tessons de poteries et autres meules dormantes, mais le plus important sur ce site, demeure certainement les restes d'habitat composés de “bâtiments ouvrant sur une seule cour” et trois mosquées, dont deux possédant un minaret en partie en pierre. De plus, des cimetières d'époque islamique ont également été retrouvés tout autour du site (Bernus et Cressier 2011). Azelik, nom actuel du site de l’ancienne capitale du royaume de Tigidda, aussi appelée Takadda ou Tacâdda par les auteurs arabes et visitée en 1353 par le géographe arabe Ibn Battūta, était une halte caravanière dans le commerce transsaharien entre Boucle du Niger et Égypte, mais aussi un centre d'exploitation et de commercialisation du cuivre. Ce ne fut pas une terminaison d’un axe commercial, mais une halte, un passage obligé pour sa ressource en eau et pour le paiement des droits de traversée du royaume, assurant ainsi la protection des marchandises. Il ne devait pas y avoir non plus de rupture de charge à cette étape, car la ville n’était pas une ville suffisamment peuplée pour développer un marché important à approvisionner, tout au plus les caravanes devaient-elles se fragmenter pour poursuivre leur route vers Gao, le Bornou ou vers le sud, ou s’unir pour marcher vers le nord.
|
|
Les Gobirawa en Ayar |
Dans cet article, je m’intéresse aux Gobirawa qui, à une époque, ont passé par l’Ayar1. Il serait vain de croire que cette communauté n’ait qu’une seule origine. Comme beaucoup de confédérations Berbère, Touareg ou même Hausa, les Gobirawa que l’on connaît aujourd’hui en tant que peuple du Hausa Bakwaï (les sept États Hausa légitimes), sont le résultat de migrations qui viennent des quatre points cardinaux et qui englobent aussi des autochtones. La diversité des traditions orales ou des écrits, des cousinages ou des us, ne reflètent en fait que les alliances qui se sont faites et défaites, de grès ou de forces, tout au long de leur histoire, par métissage ou assimilation successifs entre populations désireuses ou obligés de s’unir pour poursuivre leur histoire. Comprendre ces diversités n’est pas chose aisée.
|
|
Ibn Battūta en Ighazer, ou pas ! |
Cet article tente de comprendre les éléments que rapporte Ibn Battûta de son périple en Ighazer, afin de participer à la vision du cadre géographique et humain qu’apporte son récit à cette région, issu des traductions faites par Defrémery et Sanguinetti au milieu du XIXè et de celle de Joseph Cuoq à la fin du XXè siècle (Defrémery and Sanguinetti 1858; Cuoq 1975). Il est donc à l’évidence ethno-géo-centré sur la ville de Tacaddâ et sa région. Néanmoins pour comprendre ce cadre géographique, les sources écrites arabes médiévales apporteront un peu plus de consistance à ce récit. Ces sources sont essentiellement issues du « Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIè au XVIè siècle » de Joseph Cuoq.
A partir du XVè siècle s’instaure un fort mouvement de lettrés et religieux venus de l’ouest, des Sanhadja de Walata, Tombouctou et Tademekka. Ce mouvement semble s’intensifier avec l’avènement de Sonni Ali Ber et l’empire Songhay à la fin de ce siècle. Ces personnages professent un islam plus rigoriste et puritain, dont Al Maghili en est un représentant qui passa par Takadda, devenue dès le XIVè siècle un important centre de diffusion spirituel. A la chute de Takadda, Anisaman va prendre le relais mais uniquement sur plan religieux, Agadez s’accaparant les pouvoirs politique et économique (Bernus et Cressier 1992), puis évinçant définitivement Anisaman au XVIIè siècle.
|
|
Les débuts de l'Islam en Ighazer |
Cet article s’intéresse au développement des débuts de l’islam en Aïr, qui s’étalent du VIIIᵉ siècle au XVIᵉ siècle. Chronologiquement, cette période s’insère d’abord dans ce que j’ai appelé le Domaine de Maranda, qui ne possède pas d’entité politique ou religieuse identifiée, mais fait davantage office de milieu culturel où la rencontre des populations se fait autour de Maranda, notamment lors du passage des caravanes commerciales. Ensuite, à partir du XIᵉ-XIIᵉ siècle, c’est le royaume de Tigidda qui est considéré comme le premier sultanat entre Ighazer et Aïr et qui sera confronté au sultanat d’Agadez, dont l’avènement sera effectif au tournant du XVIᵉ siècle. La fin de Tigidda marquera également la fin d’un islam élitiste, à la charnière des XVᵉ et XVIᵉ siècles et le cadre final de cet article.
|
|
Les Masūfa ⵉⵎⴰⵙⵓⴼⵏ |
Pour la plupart des auteurs arabes médiévaux, les Masūfa ou Messufa, Imassufa, Inassufen, sont des Sanhadja, aux côtés des Gedāla et Lamtūna (Cuoq 1975). Ce sont des mulethemin, c’est à dire qu’ils portent le voile et habitent le désert. Toutes les tribus sanhadjiennes, Gueddala, Lemtuma, Messufa, Outzila, Targa, Zegaoua et Lemta, sont situées entre l’océan et Ghadamès (Baron de Slane 1982). Les Messufa peuvent être divisés en deux fractions, dont l'une, occidentale, a eu une part importante dans la fondation de l'Empire Almoravide, tandis que la fraction orientale est née sur le chemin des pèlerinages vers la Mecque et nous intéresse particulièrement ici, car elle est fondatrice de Takadda (Beltrami 1983).
|
|
Le Sultanat de l'Ayar (Aïr) |
L'Aïr géographique correspond au massif montagneux du Nord Niger, mais on dénomme plus communément les montagnes et ses dépendances territoriales politiques, comme Ayar ou Sultanat de l’Ayar, pour bien signifier que son rayonnement dépasse la montagne bleue. L’Ayar s’étend donc sur la plaine de l’Ighazer à l’ouest, sur une partie de la Tamesna au nord-ouest, jusqu’au Damergou au sud qui en est la réserve céréalière, ainsi que sur l’Ader au sud-ouest depuis la fin du XVIIè siècle et la mise en place d’une chefferie issue du Sultanat. A certaines périodes, il s’étendit même sur le Ténéré et le Kawar.
|
|
La Naissance d'In Gall |
L’histoire orale d’In Gall est diversement relatée selon les personnes qui la présente et leurs origines. Entre des récits rapportant que les Isawaghen sont les descendants de l’Askia Mohamed, ou que la fondation d'In Gall est due à des Isheriffen, ou encore issu de l’ancienne Takadda, les données archéologiques viennent compléter ces traditions orales pour aboutir à une structuration des gens d’In Gall qui ressemble fort à celle des confédérations Touareg, c’est à dire une recomposition de groupes éparpillés dans la plaine de l’Ighazer, que l’histoire géopolitique de la région a modelé. Malgré leur sédentarité, on peut alors parler de Kel In Gall. On trouvera quelques éléments du recueil des traditions orales dans cet article complémentaire.
|
|
L’Afrique selon Jean Léon l’Africain |
Le témoignage de Jean Léon l’Africain constitue une source précieuse pour comprendre la perception géographique et sociopolitique de l’Afrique au début du XVIe siècle. Issu d’un parcours singulier entre le monde musulman et chrétien, son œuvre mêle observations personnelles, récits entendus et visions européennes de l’autre. À travers sa "Description de l’Afrique", il dresse une cartographie mentale du continent, structurée par des critères à la fois physiques, ethniques et politiques.
|
|
Le recueil des traditions d'In Gall |
On parle ici peut être abusivement de traditions orales. En effet, ces témoignages ne sont pas recueillis auprès des traditionnistes qui sont les véritables porteurs de récits historiques, mais le sont auprès de tout un chacun qui détient quelques brides de son histoire, reçues vraisemblablement par ses aïeux ou grappillées dans les conversations. Il est donc difficile d’en tirer des certitudes et il n’est pas utile de vouloir faire un choix entre ces dires, mais il peut être utile de les considérer comme mémoire du temps. Elles ne sont ni vrais ni fausses, elles témoignent néanmoins de liens que les populations se donnent.
|
|
Agadez et sa suite |
Jean Léon l’Africain nous donne une image de la ville d’Agadez au début du XVIè siècle. A la différence de Gao, il n’y a pas ici de ville duale, certainement du fait de l’insécurité de la zone, Agadez est alors ceint d’une muraille. Il est vrai que la fin de la période des grands empires d’Afrique de l’ouest marque aussi la disparition des villes duales au profit de ville fortifiées, peut être parce que la cohabitation des régimes religieux et idolâtre n’est plus en vogue, surtout parmi les élites commerçantes et politiques.
|
|
La Tagaraygarayt |
Avant l’arrivée des Ouelleminden, l’Azawagh était occupé par des tribus Ineslemen et leurs dépendants. Les Kel Tamezgidda (ceux de la mosquée) mais aussi d’autres groupes comme les Iberkoreyan ou les Igdalen qui occupaient l’Azawagh et l’Ighazer. Des liens avec l’Adrar des Ifoghas existaient forcément du fait que les Igdalen et d’autres Ineslemen des Kel Attaram, les Dahushahaq ont un parlé mixte Songhay-Tamasheq similaire et se reconnaissent une parenté. De la même manière, les Iberkoreyan ont un parlé le Sinsar ou Tsétsérret qui est apparenté au berbère occidental et au Zenaga du sud mauritanien. Cette rencontre entre des populations anciennes et religieuses qui occupent l’Azawagh et les Ouelleminden venus de l’ouest, va donner naissance à une confédération originale, celle des Kel Tagaraygarayt, « ceux du milieu ».
|
|
Les Peuls Wodaabé |
« Essayer de penser les Bororos sans les zébus Bororoji serait trahir leur légende », disait Marguerite Dupire. Ce sont les seuls à posséder cette espèce de zébus, Bos indicus, à cornes en forme de lyre (Dupire 1962). Éleveurs légendaires de la bande sahélienne, les Peuls sont régulièrement ballottés par la géopolitique, leur esprit guerrier leur ayant également permis de fonder des États puissants. Les éleveurs peuls, chassés des régions agricoles méridionales en raison de la pression démographique et du développement des cultures intensives, pénètrent dans la zone pastorale jusqu'à la lisière du Sahara, occupée par les Touaregs et les Arabes (Bernus 1974). Au Niger, les Bororos, éleveurs de la race Bororoji, sont essentiellement des Wodaabé nomades.
|
|
Les Kel Ferwan |
L'origine du groupement des Kel Ferwan prend sa source près du village d'Iférouane, au nord des montagnes de l’Aïr, dans la vallée d'Aghazer, située à l’est de celle de Tin Taghodé, où une grande quantité de mil est récoltée et où l’on trouve de nombreux dattiers (Barth 1863). Ce ne serait que récemment, aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, qu’ils se seraient déplacés autour de la capitale du sultanat de l'Ayar, devenant ainsi le bâton d’un sultan sans armée. Dans certaines sources écrites, on trouve le nom de Kel Aghazer pour les désigner, le nom de Kel Ferwan leur ayant été attribué plus tardivement par les colons français, « ceux d’Iférouane », qui prit son origine de Tanasfarouat, celle d’Iférouane, autre dénomination de la reine originelle des Kel Ferwan.
|
|
Les Kel Fadey |
Les Kel Fadey appartiennent à la confédération des Kel Aïr et relèvent donc de l'autorité du Sultanat d'Agadez. Leur territoire de nomadisation s'étend au sud-ouest des falaises de Tiguidit, jusqu'aux environs de Tegidda n'Tesemt et de Fagoshia, dans la région de l'Ighazer. À l’ouest de cette zone s’étend la confédération des Ouelleminden Kel Dinnik, tandis qu’à l’est se trouvent les Kel Aïr, dont les Kel Ferwan constituent le bras armé au service du Sultan. Depuis toujours, Kel Aïr et Kel Dinnik se disputent la vassalité des tribus Kel Fadey, dont l’histoire orale relate les hauts faits, tour à tour opposés aux Ouelleminden ou aux Kel Ferwan.
|
|
Les Isawaghen |
L’histoire orale d’In Gall est diversement relatée selon les personnes qui la présente et leurs origines. Entre des récits rapportant que les Isawaghen sont les descendants d’Askia Mohamed, que la fondation d'In Gall échoie à des Isheriffen ou les relatons étroites avec Takedda et Tegidda n'Tessoumt, les données archéologiques viennent compléter ces traditions orales pour aboutir à une structuration des Kel In Gall qui ressemble fort à celle des confédérations Touareg malgré leur sédentarité, c'est à dire un agencement de divers groupes humains au grès des vissicitudes de l'histoire. On peut alors parler de Kel In Gall.
|
|
Les Igdalen |
Les Igdalen seraient présents dans l'Ighazer depuis la fin du VIIIè siècle ou le début du IXè siècle, et sont considérés comme les Berbères les plus anciennement installés dans l'Ighazer. Ils sont Isheriffen et appartiennent aux Kel Aïr sous l'autorité directe du Sultan d'Agadez. Ce sont des populations nomades d'origine Berbère, dont les us et coutumes sont similaires à celles des Kel Tamasheq, mais ils gardent entre eux un parlé spécifique à base Songhay, la Tagdal, proche de la Tasawaq des sédentaires d'In Gall. Ce sont des gens pacifiques, pieux, qui ne portent pas les armes et se mettent le plus souvent sous la protection de tribus Imajeren ou Imghad pour les défendre.
|
|
Les Périodes Migratoires |
La dynamique de mise en place des communautés peuplant actuellement l'Ighazer, se construit à partir du VIIè-VIIIè siècle. Elles sont pour l'essentiel nomades, venues de l'ouest et du nord-est sous l'impulsion des conquêtes arabes au Maghreb puis de l'invasion des Banu Hilal vers le XIème siècle. La particularité de l'Ighazer en ces contrées sahéliennes, est bien d'avoir encore un habitat sédentaire vieux de 500 ans, avec Agadez la capitale du Sultanat de l'Ayar mais aussi les bourgades d'In Gall et Tegidda n'Tesemt. Ces derniers sont des Isawaghen qui possèdent un langage propre, mélange de Songhay, Tamasheq et Arabe.
|
|
Les Iberkoreyan |
Les Berbères Iberkoreyan ont commencé à se déplacer vers le sud au VIIIè siècle et, vers le Xè siècle, des caravanes commerciales à longue distance passant par l'État Soninké du Ghana ont répandu l'influence de l'islam dans l'ouest du Soudan (Vidal Castro 2007). Les Iberkoreyan font partis de ces populations Ineslemen de l’Ighazer et de l’Azawagh, mais plus largement de toute la bande sahélo-saharienne, qui ont très probablement cheminé depuis le Maghreb occidental vers la boucle du Niger et de l’Adrar des Ifoghas vers les piémonts de l’Aïr, à une période d’émergence des grands empires Soudanais comme le Ghana et le Songhay. Ce cheminement a pu être antérieur à l’islam, mais n’a pour l’heure pas laissé de trace dans les mémoires et écrits.
|
|
Kel Gress et Iteseyen |
Les Kel Gress et les Iteseyen sont aujourd’hui groupés dans la région du Gobir au sud de l’Ader. Leur arrivée en ces terres y serait concomitante de leur expulsion ou fuite de l’Ayar, dans la seconde moitié du XVIIIè siècle. Ils n’en demeurent pas moins toujours en étroite relation avec le Sultanat d'Agadez, notamment les Iteseyen qui sont toujours les électeurs du Sultan. Ce fait dénote à lui seul une relation importante avec l’histoire de la construction politique du Sultanat dès les origines au XVè siècle et même antérieurement, puisqu’on peut établir leur arrivée en Aïr vers les XIIè-XIIIè siècles, les Kel Gress étant postérieurs aux Iteseyen en Aïr. Souvent confondues, ces deux entités tribales pourraient avoir des origines occidentales qui proposent un nouveau regard sur cette alliance politique atypique.
|
|
Le.s Transsaharien.s |
Au début du XXè siècle, le chemin de fer était l'outil moderne du développement commercial et devait être le parachèvement de la colonisation africaine. Ainsi on ne pouvait pas "développer nos colonies" sans un mode de transport moderne pour les hommes et surtout les marchandises. Nombre d'ingénieurs et de politiciens se sont donc encouragés mutuellement à mettre en œuvre une voie ferrée traversant l'Afrique et en particulier le Sahara, terre de conquête des français. Mais à force de tergiversations, seuls des tronçons de-ci de-là furent construits, comme si le souvenir de la mission Flatters, décimée en 1881 dans le sud Algérien, le laissa à jamais à quai.en, le laissa à jamais à quai.
|
|
L'Automobile en Ighazer |
Après la première guerre mondiale, les armées françaises d'Afrique développent avec des industriels des véhicules pour mieux circuler dans le désert. Se passe alors dans les années 20 une course entre ces constructeurs, Renault avec une voiture 6 roues, Citroën et sa voiture à chenille, Berliet pour les camions, etc. Ils possèdaient chacun leurs pilotes pour ouvrir un maximum de voies de ciculation en un minimum de temps. Point d'orgue de cette frénésie du désert le premier rallye partant de l'Algérie devant rejoindre Gao au Mali puis retour au point de départ en 1935.
|
|
La Période Coloniale |
Le premier explorateur à fouler le sol d'Aïr est Henrich Barth en 1853. Lors de son "excursion à Agadez", il en décrira l'Emghedeshie, langue à base Songhaï intégrant un vocable Tamasheq et Arabe, et précisera pour ce qui concerne la plaine de l'Ighazer l'implantation des villages d'In Gall et de Tegidda (Barth 1863), qu'il confond d’ailleurs avec la Takadda d'Ibn Battûta. En 1876, Erwin de Bary pénétra aussi l'Aïr mais ne put jamais le traverser entièrement, il décédera à Ghât peu avant une deuxième tentative. Plus tard en 1870, Nachtigal descendit de Mourzouk pour se rendre au Tchad, en passant par Bilma et N’Guigmi. Enfin, plus au sud de l’Ayar en 1891-1892, le Lieutenant-Colonel Monteil traversa le Niger à Say, alla jusqu’à Bilma par Sokoto, Kano, N’Guigmi, rentrant ensuite en France par Mourzouk et Tripoli (Commissariat de l’AOF 1922).
|
|
Le Poste d'In Gall |
Le 12 septembre 1904, le Lieutenant Jean entre à Agadez et fonde le premier poste militaire près du puits de Tin Shaman (Jean Lt 1909 ; Abadie 1927). Il fut bien accueilli par le Sultan qui n’aura de cesse de demander la présence française à cause de l’insécurité et de l’impossibilité de tenir son rôle. Quelques jours après le poste d’In Gall était créé, à l’occasion d’une liaison avec une reconnaissance venue de Tahoua et menée par le Capitaine Delestre. Malheureusement, les ordres de Zinder demandant le repli des postes d’In Gall et d’Agadez étaient promus et le 31 mai 1905, de nouveau les cités de l’Aïr étaient laissées aux pillards qui châtièrent les populations accueillantes.